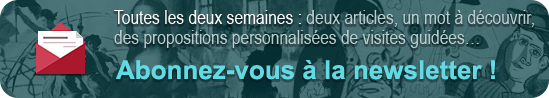Credits image :
Hayward Gallery
Le
1 mars 2019,
Voilà un artiste majeur qui sait décidément aborder des
questions socio-politiques de première importance avec beaucoup de finesse et
via des modalités d'expression aussi variées que maîtrisées. Nous vous avions
déjà parlé ici de son exposition au Mac/Val (2018) "Les racines poussent
aussi dans le béton" réflexion poétique et engagée sur les grands
ensembles construits à partir des années 1950 dans les banlieues françaises, où l'artiste
franco-algérien a vécu. Collages, films, photo, installations, sculptures, tous
les moyens étaient bons pour y provoquer la réflexion. Quel regard porter sur
ces lieux de mise au ban pour des populations immigrées et défavorisées, les
mêmes qui furent sous le joug de la France pendant la colonisation? La froideur
de l'architecture, sa standardisation extrême, son éloignement des
centre-villes provoquent une sorte de déni collectif chez ceux qui n'y ont pas
vécu, qui empêche d'approcher la réalité des destins individuels et familiaux,
la fabrication complexe d'identités multiples, parfois sources de conflits
intérieurs, mais aussi riches de toutes leurs cultures. Kader Attia y remédie
avec brio, leur restitue toute leur dignité en les plaçant au cœur de ses
dispositifs artistiques et en soumettant le visiteur à ses propres
contradictions.
L'année 2018 a été marquée par un grand débat autour de la restitution d'œuvres d'art qui remplissent nos musées (à commencer par le musée du Quai Branly) aux pays d'Afrique dont elles sont issues, qui leur ont été spoliées pendant la colonisation. Des œuvres souvent présentées hors contexte, qui sont parfois aussi des objets rituels vidés de leur substance, que les jeunes générations des pays où ils ont été produits ne peuvent plus admirer, sauf à avoir les moyens de visiter les grands musées européens. Un premier pas symbolique a été accompli par la France après le rapport Savoy-Sarr, qui établit qu'un certain nombre d'objets d'art vont être progressivement restitués au Bénin.
Cette appropriation culturelle pose de multiples questions, et Attia s'y attaque frontalement avec cette nouvelle exposition, intitulée "Le musée de l'émotion" à la Hayward Gallery – dont les lignes brutalistes font idéalement écho aux préoccupations architecturales de l'artiste. Cette exposition majeure marque un tournant dans la carrière de Kader Attia, par son ambition, ses prises de position et la poursuite d'une réflexion cohérente autour de la perte, de la réparation et de la discrimination.
Classer, hiérarchiser, catégoriser
Avec cette exposition, Kader Attia réussit un coup de maître en questionnant la nature même des musées occidentaux. Les catégories de pensée qui président à leur conception sont encore très imprégnées de préjugés hérités du colonialisme, qui témoignent d'un rapport prédateur au monde : à ce titre, quand il montre dans une vitrine à l'ancienne un léopard naturalisé à côté d'un masque africain ("Measure and Control"), on ne peut s'empêcher de sursauter. Oui, cette façon de présenter l'animal et la culture relève bien d'une même forme de domination, d'une hiérarchisation évidente. Nature et culture "ethnographique" deviennent des objets de curiosité, des objets exotiques, dont nous pouvons jouir à loisir. Mais au détriment de qui, de quoi?
L'exposition "Picasso et les maîtres" au Grand Palais, il y a une dizaine d'années, avait ainsi fait réagir Kader Attia, car l'influence des "arts premiers" n'y était nullement évoquée, alors qu'il est connu que Picasso a emprunté beaucoup de ses motifs cubistes aux masques africains. La réponse de Kader Attia, à la Hayward Gallery, prend la forme d'un masque traditionnel recouvert de tessons de miroirs, permettant à chaque visiteur de composer son propre autoportrait cubiste tout en réfléchissant à l'appropriation culturelle chez les grands de l'art occidental du 20e siècle. Kader Attia montre ainsi que les grands artistes africains des siècles passés – le plus souvent anonymes, eux - ont ainsi été les maîtres de Picasso, dans un renversement complet de perspective. Il convient donc de reconnaître leur importance, leur influence, et de cesser de les instrumentaliser à tout bout de champ. Depuis, les mentalités ont évolué, puisque le Quai Branly a consacré toute une exposition à la question en 2017, avec "Picasso primitif".
Il y aurait certes beaucoup à dire, aussi, sur ces termes (arts premiers, primitifs) hérités des années 1970 et qui continuent de produire une forme de classification qui n'a pas de sens. Mais c'est un autre sujet.
Un énorme travail d'archiviste
Impossible ici de parler de toutes les œuvres présentées à Londres, tant le projet est ambitieux et important, mais attardons-nous un instant sur cette immense salle qui ressemble aux réserves d'un grand musée, avec ses étagères métalliques. Une salle qui donne le tournis, tant le travail accompli y est faramineux, tant les références accumulées nous font voyager dans l'histoire du 20è siècle et dans l'histoire de nos catégories de pensée.
Ce qui domine ici, c'est une impression d'écrasement : l'accumulation d'objets renvoie aussi aux réserves des magasins… et le parallèle avec notre société consumériste s'impose d'emblée. Oui, les musées sont aussi des lieux de consommation, et nous devons toujours interroger notre rapport aux objets présentés. Quelles ont été leurs conditions d'acquisition? Pourquoi sont-ils disposés de telle ou telle manière? Comment sont-ils classés? Décrits? Tout ce que nous prenons pour acquis relève évidemment de constructions historiques et culturelles Ici les hommes sont en première ligne : sur les étagères se trouvent des bustes de "gueules cassées" de la guerre de 1914-1918 (que l'on retrouve dans un diaporama insoutenable au fond de la salle), côtoyant d'autres bustes de facture plus classique, comme ceux que l'on peut voir au musée de l'homme, qui représentent des femmes et des hommes africains aux visages scarifiés. Deux formes de violence différentes, deux modalités de réparation différentes.
Le rapprochement de la colonisation et de la guerre de 1914-1918 fait sens à plusieurs titres : d'abord, d'un point de vue historique, ce sont deux périodes qui coïncident. Ensuite, la notion d'appropriation les rassemble : dans un cas, les jeunes gens qui partirent au front "la fleur au fusil" (dont évidemment des garnisons issues des populations colonisées, avec par exemple les "tirailleurs sénégalais"). Chair à canon, simples objets, instruments de la guerre. Les livres d'histoire qui sont vissés sur les étagères leur redonnent un visage et n'en rend la tragédie que plus pregnante (on parle de 18,6 millions de morts, et cette plaie n'a qu'un siècle).
D'un autre côté, les corps du continent africain soumis à un regard qui se veut supérieur, un regard raciste, sexualisant les corps, essentialisant les êtres. Des objets, là aussi. Qu'il s'agisse de "Nos soldats" ou de "Nos africains", ces formes d'appropriation écoeurent et on se demande forcément ce qui subsiste aujourd'hui de cette mentalité dans notre rapport à l'autre. Les piles de livres se succèdent : on ne voit que la couverture de ceux qui se trouvent en haut des piles, car les autres sont inaccessibles, les ouvrages étant fixés entre eux par des vis et des boulons sur les étagères. Une métaphore parfaite de la mémoire qui se sédimente et des préjugés tenaces, "indéboulonnables", de la culture et de l'éducation qui façonnent notre pensée, dont nous n'avons souvent même plus conscience. Les vis et les boulons sont aussi le souvenir d'un geste violent. Attia souligne la violence symbolique de ces images.
La réparation est un autre sujet qui passionne Kader Attia, qui se penche depuis longtemps sur les aspects psychologiques et sociologiques des traumas, des blessures, sur la notion de membre-fantôme. Il aborde ici sa dimension médicale : la première guerre mondiale a en effet été un immense laboratoire technologique en matière d'armements (bon nombre de machines à tuer y ont été expérimentées avec le succès que l'on sait), mais aussi un laboratoire médical et chirurgical de première importance, dont les gueules cassées ou les estropiés ont été les premiers cobayes. Que veut dire Kader Attia à travers l'exposition de ces manuels de médecine, ces images de prothèses, ces visages défoncés? Que la technologie est à la fois au service de la destruction et de la réparation, dans un même mouvement absurde. Des armes pour tuer, des techniques pour reconstruire. Une façon perverse de dominer le monde, la nature, de s'arroger le droit de casser, d'abîmer, de détruire, pour ensuite inventer des techniques sophistiquées de réparation. Où est la barbarie? Où est la civilisation? Les courants transhumanistes actuels ne creusent-ils pas le même sillon?
On sort de cette exposition chamboulé, désorienté, perturbé par tant de questionnements, mais ébloui aussi par la capacité de l'art à provoquer des prises de conscience et des remises en cause par des moyens esthétiques. Grand artiste, grand penseur (et panseur?), Kader Attia nous donne les moyens de changer de regard sur le monde, par le biais de l'émotion.
Kader Attia, The Museum of Emotion, à la Hayward Gallery, Londres, jusqu'au 6 mai 2019.
Sonia Zannad / Mes sorties culture
Ecrivez à la rédaction : szannad@messortiesculture.com
L'année 2018 a été marquée par un grand débat autour de la restitution d'œuvres d'art qui remplissent nos musées (à commencer par le musée du Quai Branly) aux pays d'Afrique dont elles sont issues, qui leur ont été spoliées pendant la colonisation. Des œuvres souvent présentées hors contexte, qui sont parfois aussi des objets rituels vidés de leur substance, que les jeunes générations des pays où ils ont été produits ne peuvent plus admirer, sauf à avoir les moyens de visiter les grands musées européens. Un premier pas symbolique a été accompli par la France après le rapport Savoy-Sarr, qui établit qu'un certain nombre d'objets d'art vont être progressivement restitués au Bénin.
Cette appropriation culturelle pose de multiples questions, et Attia s'y attaque frontalement avec cette nouvelle exposition, intitulée "Le musée de l'émotion" à la Hayward Gallery – dont les lignes brutalistes font idéalement écho aux préoccupations architecturales de l'artiste. Cette exposition majeure marque un tournant dans la carrière de Kader Attia, par son ambition, ses prises de position et la poursuite d'une réflexion cohérente autour de la perte, de la réparation et de la discrimination.
Classer, hiérarchiser, catégoriser
Avec cette exposition, Kader Attia réussit un coup de maître en questionnant la nature même des musées occidentaux. Les catégories de pensée qui président à leur conception sont encore très imprégnées de préjugés hérités du colonialisme, qui témoignent d'un rapport prédateur au monde : à ce titre, quand il montre dans une vitrine à l'ancienne un léopard naturalisé à côté d'un masque africain ("Measure and Control"), on ne peut s'empêcher de sursauter. Oui, cette façon de présenter l'animal et la culture relève bien d'une même forme de domination, d'une hiérarchisation évidente. Nature et culture "ethnographique" deviennent des objets de curiosité, des objets exotiques, dont nous pouvons jouir à loisir. Mais au détriment de qui, de quoi?
L'exposition "Picasso et les maîtres" au Grand Palais, il y a une dizaine d'années, avait ainsi fait réagir Kader Attia, car l'influence des "arts premiers" n'y était nullement évoquée, alors qu'il est connu que Picasso a emprunté beaucoup de ses motifs cubistes aux masques africains. La réponse de Kader Attia, à la Hayward Gallery, prend la forme d'un masque traditionnel recouvert de tessons de miroirs, permettant à chaque visiteur de composer son propre autoportrait cubiste tout en réfléchissant à l'appropriation culturelle chez les grands de l'art occidental du 20e siècle. Kader Attia montre ainsi que les grands artistes africains des siècles passés – le plus souvent anonymes, eux - ont ainsi été les maîtres de Picasso, dans un renversement complet de perspective. Il convient donc de reconnaître leur importance, leur influence, et de cesser de les instrumentaliser à tout bout de champ. Depuis, les mentalités ont évolué, puisque le Quai Branly a consacré toute une exposition à la question en 2017, avec "Picasso primitif".
Il y aurait certes beaucoup à dire, aussi, sur ces termes (arts premiers, primitifs) hérités des années 1970 et qui continuent de produire une forme de classification qui n'a pas de sens. Mais c'est un autre sujet.
Un énorme travail d'archiviste
Impossible ici de parler de toutes les œuvres présentées à Londres, tant le projet est ambitieux et important, mais attardons-nous un instant sur cette immense salle qui ressemble aux réserves d'un grand musée, avec ses étagères métalliques. Une salle qui donne le tournis, tant le travail accompli y est faramineux, tant les références accumulées nous font voyager dans l'histoire du 20è siècle et dans l'histoire de nos catégories de pensée.
Ce qui domine ici, c'est une impression d'écrasement : l'accumulation d'objets renvoie aussi aux réserves des magasins… et le parallèle avec notre société consumériste s'impose d'emblée. Oui, les musées sont aussi des lieux de consommation, et nous devons toujours interroger notre rapport aux objets présentés. Quelles ont été leurs conditions d'acquisition? Pourquoi sont-ils disposés de telle ou telle manière? Comment sont-ils classés? Décrits? Tout ce que nous prenons pour acquis relève évidemment de constructions historiques et culturelles Ici les hommes sont en première ligne : sur les étagères se trouvent des bustes de "gueules cassées" de la guerre de 1914-1918 (que l'on retrouve dans un diaporama insoutenable au fond de la salle), côtoyant d'autres bustes de facture plus classique, comme ceux que l'on peut voir au musée de l'homme, qui représentent des femmes et des hommes africains aux visages scarifiés. Deux formes de violence différentes, deux modalités de réparation différentes.
Le rapprochement de la colonisation et de la guerre de 1914-1918 fait sens à plusieurs titres : d'abord, d'un point de vue historique, ce sont deux périodes qui coïncident. Ensuite, la notion d'appropriation les rassemble : dans un cas, les jeunes gens qui partirent au front "la fleur au fusil" (dont évidemment des garnisons issues des populations colonisées, avec par exemple les "tirailleurs sénégalais"). Chair à canon, simples objets, instruments de la guerre. Les livres d'histoire qui sont vissés sur les étagères leur redonnent un visage et n'en rend la tragédie que plus pregnante (on parle de 18,6 millions de morts, et cette plaie n'a qu'un siècle).
D'un autre côté, les corps du continent africain soumis à un regard qui se veut supérieur, un regard raciste, sexualisant les corps, essentialisant les êtres. Des objets, là aussi. Qu'il s'agisse de "Nos soldats" ou de "Nos africains", ces formes d'appropriation écoeurent et on se demande forcément ce qui subsiste aujourd'hui de cette mentalité dans notre rapport à l'autre. Les piles de livres se succèdent : on ne voit que la couverture de ceux qui se trouvent en haut des piles, car les autres sont inaccessibles, les ouvrages étant fixés entre eux par des vis et des boulons sur les étagères. Une métaphore parfaite de la mémoire qui se sédimente et des préjugés tenaces, "indéboulonnables", de la culture et de l'éducation qui façonnent notre pensée, dont nous n'avons souvent même plus conscience. Les vis et les boulons sont aussi le souvenir d'un geste violent. Attia souligne la violence symbolique de ces images.
La réparation est un autre sujet qui passionne Kader Attia, qui se penche depuis longtemps sur les aspects psychologiques et sociologiques des traumas, des blessures, sur la notion de membre-fantôme. Il aborde ici sa dimension médicale : la première guerre mondiale a en effet été un immense laboratoire technologique en matière d'armements (bon nombre de machines à tuer y ont été expérimentées avec le succès que l'on sait), mais aussi un laboratoire médical et chirurgical de première importance, dont les gueules cassées ou les estropiés ont été les premiers cobayes. Que veut dire Kader Attia à travers l'exposition de ces manuels de médecine, ces images de prothèses, ces visages défoncés? Que la technologie est à la fois au service de la destruction et de la réparation, dans un même mouvement absurde. Des armes pour tuer, des techniques pour reconstruire. Une façon perverse de dominer le monde, la nature, de s'arroger le droit de casser, d'abîmer, de détruire, pour ensuite inventer des techniques sophistiquées de réparation. Où est la barbarie? Où est la civilisation? Les courants transhumanistes actuels ne creusent-ils pas le même sillon?
On sort de cette exposition chamboulé, désorienté, perturbé par tant de questionnements, mais ébloui aussi par la capacité de l'art à provoquer des prises de conscience et des remises en cause par des moyens esthétiques. Grand artiste, grand penseur (et panseur?), Kader Attia nous donne les moyens de changer de regard sur le monde, par le biais de l'émotion.
Kader Attia, The Museum of Emotion, à la Hayward Gallery, Londres, jusqu'au 6 mai 2019.
Sonia Zannad / Mes sorties culture
Ecrivez à la rédaction : szannad@messortiesculture.com